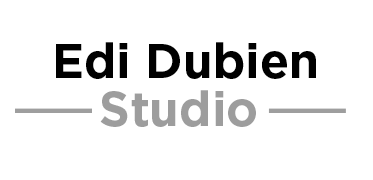2023, Les coeurs envolés avec les mots de Christophe Honoré – Galerie Alain Gutharc 7 rue saint-claude Paris 3e
Exposition du 11 mars au 22 avril 2023
Texte de Christophe Honoré
Je regardais les dessins d’Edi Dubien, et je me suis mis à leur donner des titres : « la nuit et le rêveur », « et s’en aller », « un soleil couchant de quelques jours », « à l’amoureux, l’amour », « l’été des cavaliers », « une centaine de corps », « chagrin de tout », « la vie est dégueulasse », « comme ils font tous », « le dernier garçon »… et c’était un plaisir troublant que de poser des mots sur ses images, sans trier, sans ordre, juste pour la joie d’associer, déplier leur émotion dans la langue, mais, peu à peu, un soupçon a fait tourner mon plaisir, l’a caillé en blocs de gène, une honte s’est installée peu à peu, a tout détruit et s’est mise à régner. Soudain j’ai eu l’impression par ces quelques mots que je m’étais autorisé, d’avoir été indélicat, déplacé, d’avoir voulu désigner, montrer du doigt.
Et j’ai pensé que les dessins d’Edi étaient si évidemment silencieux, officieux, qu’ils se présentaient devant nous dans un tel évanouissement des choses, que les nommer était de ma part presque une profanation. Et peut-être même que les voir seulement, prendre un temps pour les regarder, les détailler, suffisaient à provoquer chez moi un sentiment de culpabilité.
Comme lorsqu’on surprend la nudité d’un être qui se croyait seul au monde et en sécurité de tout regard et à qui l’on impose nos yeux en prétendant qu’ils ne sont là que par pur hasard. J’effaçais alors tous les titres de ma mémoire, m’efforçais de ne plus regarder qu’à peine, glissant rapidement d’un dessin à une peinture, dirigeant mon attention sur les pelages plutôt que sur les peaux, mais c’était un effort vain, l’indignité pesait sur moi.
Plus je me restreignais, plus les reproches déferlaient. Je devais vite penser à autre chose, me détourner, chasser ces idées et m’est venu à ce moment en tête une phrase entendue dans un film de Robert Bresson, « La femme Douce ».
J’ai abandonné les images d’Edi et me suis mis à fouiller dans les images du film, pour retrouver la réplique exacte, prononcée sur ce ton particulier des acteurs de Bresson, sans un vernis d’intention, presque sans sens visé, et
je l’ai retrouvée cette phrase qui dit : « La faute venait de moi, de l’idée ridicule qu’un homme se fait d’une femme, je voulais prendre et ne rien donner, te prendre et ne rien te donner, mais tu auras tout tu verras, je ferai un paradis pour toi. »
Je suis revenu vers les images d’Edi avec cette phrase, et elle devint comme une lumière qui me permettait de m’approcher, d’éclairer, et j’ai pu prendre mon temps de nouveau, attendre en regardant, attendre devant les enfants et les garçons aux lèvres closes. Laissant s’établir entre nous une conversation imaginaire. Des paroles enfin plutôt que des mots. Et il m’a semblé qu’on parlait de ça, que quelque chose leur avait été pris sans que rien ne leur soit donné, et aussi qu’on avait tous dérobé quelque chose à quelqu’un sans rien lui apporter.
Et les paroles entre nous se sont mises à résonner sur le paradis, le paradis promis par l’homme à la femme douce de Bresson. Et là, c’était clair, tranchant, c’était dit qu’il faut être con comme un monstre pour promettre un paradis, on ne récompense jamais personne avec un paradis, on ne paye jamais personne d’un paradis.
L’amour qui prétend construire un paradis est une violence, un enfer. Pourtant, si souvent, n’avons nous pas permis en souriant qu’on nous prenne, allez disons notre beauté, contre une promesse de paradis ?
N’avons-nous pas tous permis qu’on se serve en nous, qu’on fasse de nous un oubli ?
Et pour ne pas céder à la tristesse encombrante de telles questions, dont je n’étais pas certain qu’elles appartenaient à cette conversation imaginaire entre les images d’Edi et moi ou bien à une conversation plus ancienne conservée dans ma mémoire,
je me suis blotti contre les coccinelles d’Edi, contre ses renards, ses lapins, et ses fougères et ses chardons, avec cette manière si unique que possède Edi de nous donner l’impression que l’humain, l’animal et le végétal sont fabriqués de la même matière, comme une émanation commune, une apparition solidaire ; et tout contre eux, je me suis dit que si les figures de garçons ou d’enfants me semblaient marquées par un vide, qu’il me semblait qu’on leur avait tout pris sans rien leur donner, il me semblait aussi que les hommes ou le monde qui avaient par effraction arraché une part d’eux, avaient dans le même temps imprimé en eux quelque chose, un mouvement inédit, une douceur qui scalpe. Que de leurs cicatrices, s’échappaient une prolongation inattendue d’eux, un souffle nouveau comme une bouture née d’un rameau, et qui leur appartenait mais qu’ils ne possédaient pas encore avant qu’on se serve en eux. Que cet endroit rêvé en eux, défini et discernable dans les marques laissées par ceux qui leur ont tout pris sans rien leur donner, était bel et bien un jardin révélé par Edi Dubien, retrouvé inlassablement, comme une preuve éphémère qui doit se répéter sans cesse parce qu’elle disparaît à peine est-elle affichée.
Qu’il fallait toujours recommencer, peindre, dessiner encore et encore, parce
que le paradis d’Edi était à la ressemblance d’une nuit, qui s’achevait chaque fois, chaque fois revenait.
Christophe Honoré.